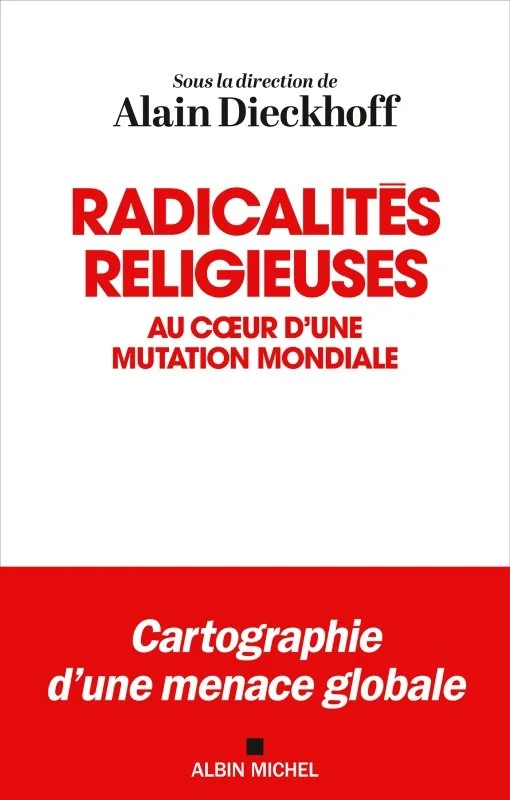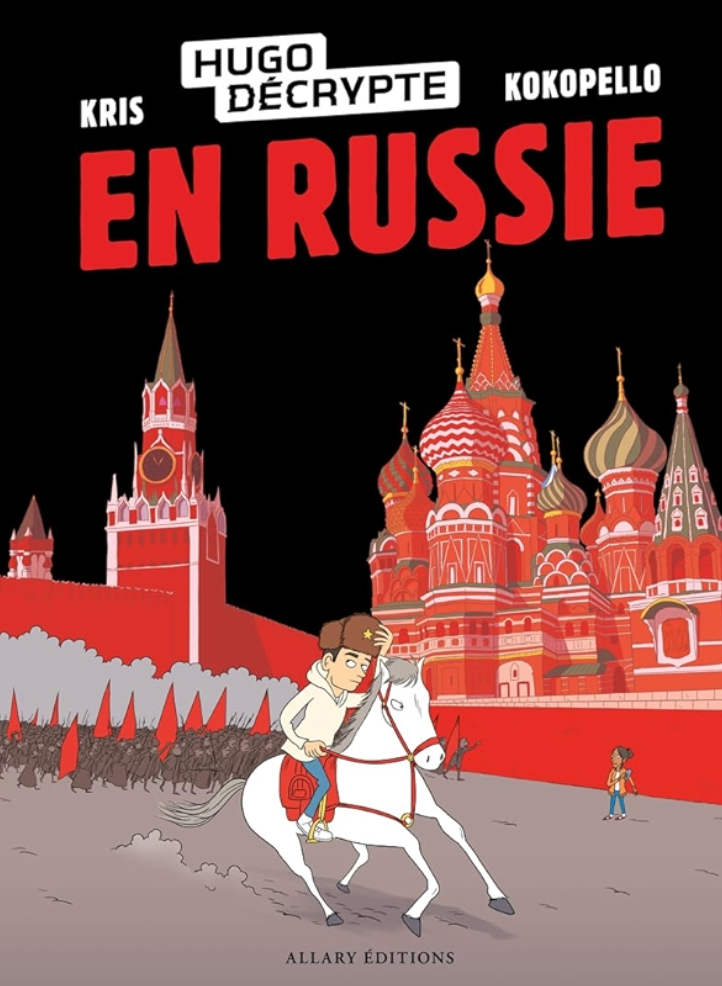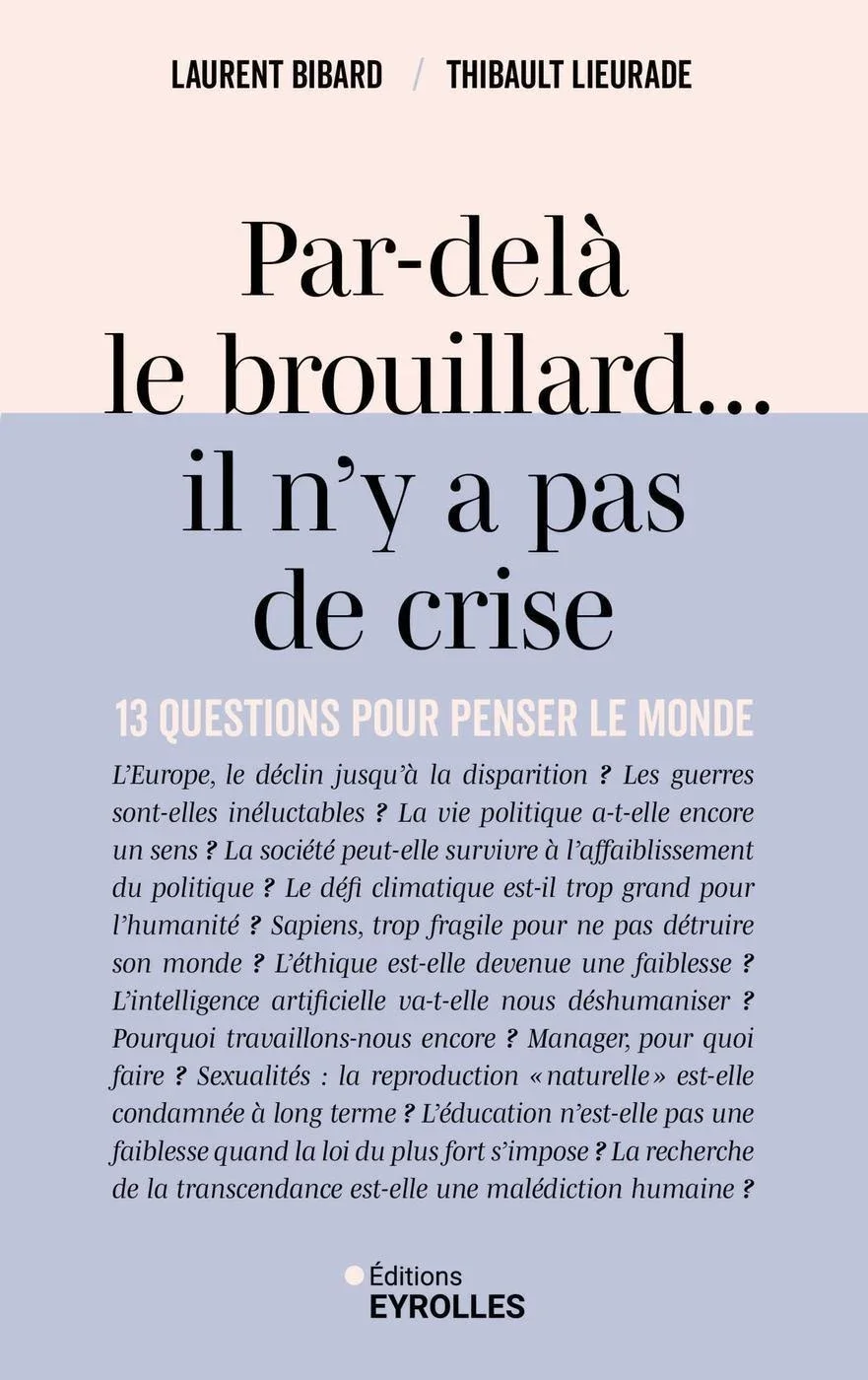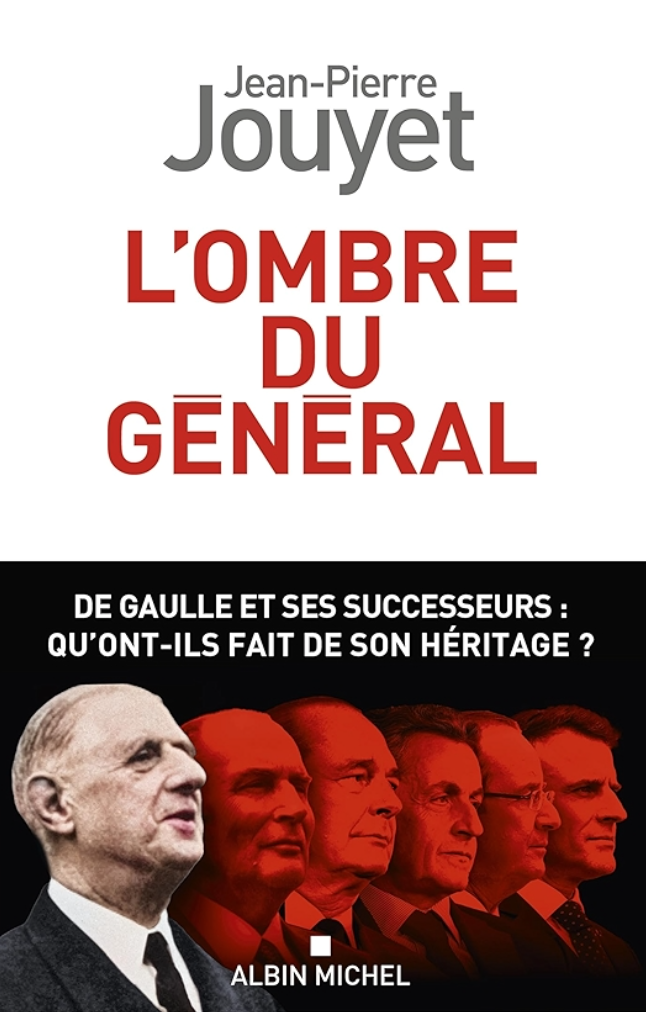Les livres politiques de novembre 2025
Tous les mois, Émile vous propose de découvrir une série de livres abordant des questions politiques sous différents angles. Ce mois-ci : état des lieux de la radicalité religieuse dans le monde, voyage historique en Russie, analyse de l’évolution de la notion de populisme, décryptage de la situation politique française, réflexions sur la science et la santé…
Par Lisa Dossou et Lise Mai
Radicalités religieuses : au coeur d’une mutation mondiale
Pendant des années, le spectre de la religion semblait s’éloigner de son rôle jadis prépondérant dans les relations internationales. Pourtant, depuis le 11 septembre 2001 et a fortiori ces dernières années aux États-Unis, en Inde, au Proche-Orient ou encore en Europe, la religion apparaît comme un facteur d’identification très fort qui, loin d’avoir perdu de la force du fait d’une soi-disant modernité sécularisatrice, a su se recomposer et renouveler son attractivité.
Dans cet ouvrage, Alain Dieckhoff a ainsi réuni les spécialistes du sujet pour faire un panorama de la situation. Après avoir analysé les liens entre religion, ethnicité, pouvoir et radicalités, les auteurs et autrices nous guident à travers le monde pour explorer les ressorts de cette transformation de la place de la religion sur la scène mondiale.
Sous la direction de :
Alain Dieckhoff (promo 87) est directeur de recherche CNRS au CERI de Sciences Po. Spécialiste de la société israélienne et du conflit israélo-arabe, il a aussi mené des recherches sur le nationalisme contemporain, le populisme et les rapports entre religion et politique.
Avec :
Mohamed-Ali Adraoui (promo 05), Brahima Afrit (promo 12), Adam Baczko, Bayram Balci (promo 16), Amélie Blom (promo 92), Christophe Jaffrelot (promo 85), Denis Lacorne (promo 67), Stéphane Lacroix (promo 03), Aminah Mohammad-Arif (promo 20), Denis Pelletier, Kathy Rousselet (promo 86), Olivier Roy (promo 96), Paul Zawadzki
Hugodécrypte en Russie
Pour mieux comprendre la Russie atuelle, Hugo Travers emmène le lecteur dans un grand voyage à travers les époques. Pour sa première bande dessinée, le journaliste retrace les grandes étapes de l’histoire russe, de sa création au IXème siècle jusqu’à l’invasion de l’Ukraine, en passant par la bataille de la Moskowa, la révolution bolchevique ou encore l’avènement du stalinisme. On y rencontre de grandes figures historiques telles qu’Ivan le Terrible, Pierre le Grand ou Catherine II.
La création et la chute de l’U.R.S.S. y sont également retracées, avant d’arriver à la période contemporaine, condensée dans un chapitre intitulé « La guerre de Poutine ». Un vrai cours d’histoire condensé et illustré pour le bonheur des plus jeunes (et des plus âgés) !
L’auteur
Hugo Travers (promo 20) est journaliste et vidéaste. Il a créé la chaîne Youtube HugoDécrypte cumulant 1,9 million d’abonnés et décliné son offre informationelle sur Instagram et TikTok. Il s’est rendu en Ukraine à deux reprises depuis 2023 afin de documenter l’offensive russe, fidèle à sa démarche de démocratisation de l’information.
Le scénariste
Kris est scénariste, spécialisé dans la bande dessinée et le court-métrage. Il a notamment publié Un Homme est mort (Futuropolis, 2003) et Les Brigades du Temps (Dupuis, 2012, 2014), et adapté nombre de ses projets au format vidéo à l’instar de Mon Père était boxeur (Futuropolis, 2016)
Le dessinateur
Kokopello est dessinateur et auteur de bandes dessinées. Influencé par l’art cinématographique, il a notamment écrit Nonsense et Cinéma (Lobster Films, 2018) avant de publier Palais Bourbon, dans les coulisses de l’Assemblée nationale (Dargaud, Seuil 2021).
Hugodécrypte en Russie. Hugo Travers, Kokopello, Kris. Éditions Allary, 2025. 208 pages, 26€.
Pour l’amour du peuple : Histoire du populisme en France
Le populisme n’est pas un fait nouveau. L’historien Marc Lazar nous rappelle qu’il existe en France depuis le boulangisme sous la IIIème République. Mais qu’ont en commun le général Boulanger et Marine Le Pen, les maoïstes et les Gilets jaunes, Jean-Luc Mélenchon et Bernard Tapie – tous taxés de « populistes » ? Leurs objectifs politiques ont beau être contradictoires, ils partagent ce qui forme le cœur de leur discours : une exaltation du peuple, uni dans la même volonté, ainsi qu'un rejet affiché des élites. L’auteur argumente également que le système représentatif de la Vème République creuse le décalage entre le pouvoir exécutif et la voix du peuple.
Dans cet essai, Marc Lazar s'attache à définir le phénomène populiste, analyse chacune de ses manifestations et explique de quelle manière son charme opère, aujourd'hui plus que jamais.
L’auteur
Marc Lazar est professeur des universités en histoire et sociologie politique à Sciences Po. Il a notamment écrit Le Communisme, une passion française (Perrin, 2002) et Peuplecratie. La métamorphose de nos démocraties (Gallimard, 2019).
La démocratie à l’état gazeux
Notre démocratie est-elle en train de muter ? Gilles Finchelstein dresse, en tout cas, le constat d’un changement d’état. Filant la métaphore chimique de la transformation de la matière, l’auteur estime que notre démocratie était solide en 1945, ancrée dans son clivage gauche-droite, avant de devenir liquide en 1992 lors de la signature du traité de Maastricht qui bouscule ce clivage partisan traditionnel. Elle aurait atteint l’état gazeux lors de l’élection présidentielle de 2017 qui voit la gauche et la droite absentes du second tour, faisant suite à l’émergence de la nouvelle gauche radicale et l’enracinement de l’extrême-droite. Les propositions du Rassemblement national comme la suppression du droit du sol et la réintroduction du principe de préférence seraient des menaces pour l’État de droit, risquant de mener notre démocratie à l’imprévisible état plasma.
L’auteur
Gilles Finchelstein (promo 88) est secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès. Il a occupé plusieurs postes de conseiller dans les cabinets ministériels de Lionel Jospin, au sein du ministère de l’Économie et des Finances ainsi qu’au sein du ministère des Affaires européennes. Il a notamment écrit Le Monde d’après : une crise sans précédent (2009), La Dictature de l’urgence (2011) et Pièges d’identités (2016).
Par-delà le brouillard… il n’y a pas de crises
Les crises politiques, sociales, environnementales et géopolitiques déstabilisent notre monde. Si les défis humains changent de forme, ils demeurent les mêmes depuis toujours : à nous de tirer, au travers des spécificités de notre époque, les leçons philosophiques sur notre espèce. Les échanges entre Laurent Bibard, philosophe, et Thibault Lieurade, journaliste, nous éclairent.
Au travers de 13 questions abordant des thèmes variés tels que l’Europe, l’éthique, les guerres ou l’éducation, l’ouvrage relie les grands enjeux des sociétés contemporaines à leurs racines plus profondes. Les échanges sont l’occasion de réfléchir sur le long terme aux réponses proposées face aux crises du XXIe siècle. Ils nous rappellent l’importance de notre héritage de pensée dans la prise de décision.
Les auteurs
Laurent Bibard (promo 86) est professeur de philosophie et de gestion à l’ESSEC. Il est consultant dans les secteurs de l’industrie, de la santé et de l’énergie et a publié L’intelligence artificielle n’est pas une question technologique (Mikros Essais, 2024).
Thibault Lieurade a été chef de la rubrique Économie et entreprise à The Conversation et a été journaliste chez TF1, France 24 et M6.
L’ombre du général
Le Général de Gaulle a laissé derrière lui un héritage politique marqué par un pouvoir exécutif fort et ambitieux. L’auteur, qui a successivement servi les présidents Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron, analyse l’héritage de 1958 sous leurs mandats. Il dresse le constat des jeux de pouvoirs qui malmènent l’exercice de la politique en France.
De l’élection au suffrage universel direct à la rationalisation du Parlement, il revient sur les transformations de la Vème République pour expliquer l’essence du gaullisme. L’auteur démontre que la fonction présidentielle a perdu progressivement la confiance des citoyens sous le poids des calculs politiciens, de l’incapacité à mener des réformes et la mauvaise qualité de la classe politique.
L’auteur
Jean-Pierre Jouyet (promo 76) a successivement été haut fonctionnaire, directeur du Trésor, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, secrétaire d’État puis secrétaire général de l’Élysée sous François Hollande, avant d’être nommé ambassadeur au Royaume-Uni en 2017. Il a écrit plusieurs ouvrages dont L’Envers du décor (2020) et Notre vieux royaume (2022).
L’ombre du général, Jean-Pierre Jouyet, Albin Michel 2025, 240 pages, 20,90 €
Redonner sa grandeur à la politique
Dans cet essai, Alexandre Mancino fait le constat de l’épuisement d’une ère politique, de la fin d’un cycle. Qui dit fin de cycle dit aussi début d’un nouveau, qui reste encore à définir en France après plusieurs années de confusion et d’instabilité. C’est ce que propose l’auteur, affirmant s’exprimer au nom d’une génération qui aspire à la nouveauté et au changement. Une génération qui a fait l’expérience de l’échec d’une classe politique désuette qui ne parvient plus à fédérer ni à mobiliser ses citoyens.
Son analyse des causes de la situation actuelle se poursuit par une proposition de réenchantement de la politique qui redonne de la place aux citoyens tout en assumant un conservatisme régalien et un libéralisme politique. Appelant à entrer dans une démarche d’innovation politique, l’auteur insiste sur l’importance de rassembler les Français autour de valeurs partagées et d’un sentiment d’espoir en le renouveau de la politique pour envisager l’avenir sereinement.
L’auteur
Diplômé d’HEC, de Sciences Po, et d’un master en droit, Alexandre Mancino (promo 18) est avocat, entrepreneur et président du Cercle Orion, think tank et forum politique pour une nouvelle génération.
Redonner sa grandeur à la politique, Alexandre Mancino, Temporis, 2025, 275 pages 20 €
Quand la France se détourne de la science
En France, l’héritage intellectuel des Lumières est contrebalancé par une défiance croissante envers la science. Les auteurs de cet essai s’interrogent : pourquoi nous sommes-nous détournés de la certitude rationnelle, remettant en cause l’autorité des faits au profit des scepticismes et des controverses ? Ce phénomène diminue l’intérêt porté vers la recherche scientifique et menace l’intégrité démocratique de notre pays, dont la stabilité politique va de pair avec le droit à l’information.
En analysant les crises telles que la vache folle et Tchernobyl, Karine Berger et Grégoire Biasini démontrent la responsabilité des élites politiques et médiatiques mais également des réseaux sociaux dans la diffusion du doute en France. Ils proposent des solutions pour réparer la confiance en la science, indispensable à notre communauté.
Les auteurs
Karine Berger (promo 98) est économiste et ancienne députée des Hautes-Alpes. Elle a occupé les postes de directrice financière chez Euler-Hermès et est actuellement directrice financière à l’Insee. Elle a notamment écrit Les Trente Glorieuses sont devant nous (rue Fromentin, 2011) et La Culture sans État (Odile Jacob, 2016).
Grégoire Biasini (promo 91) a occupé divers postes dans la communication, notamment celui de chef de la communication de la Société nationale Maritime Corse-Méditerranée et a fondé le cabinet de conseil Palomar.
Épuisé
À 28 ans, la vie de l’auteur bascule : il est terrassé par une fatigue inexplicable. Le diagnostic tombe au bout de trois ans, il est atteint d’encéphalomyélite myalgique. Il documente son quotidien rythmé par l’angoisse de cette maladie chronique dans un journal de bord : le lecteur assiste aux grandes étapes de ce dur chemin, de son licenciement à la volonté d’une reconnaissance collective. Ce récit, à mi-chemin entre le témoignage et l’essai philosophique, fait état des souffrances physiques et psychologiques des personnes malades dans les sociétés contemporaines : la perte d’un emploi, des amis, de la famille puis du statut social arrachent l’individu à la collectivité pour le placer dans un isolement persistant. S’y ajoutent l’absence d’accompagnement psychologique et la prise en charge lacunaire des symptômes.
L’auteur montre que, du fait de leur état physique, les malades ne peuvent “faire communauté” pour défendre leurs intérêts : à moins d’être aidés d’un tiers en bonne santé, ils sont invisibilisés. Plaidoyer pour une visibilisation des malades oubliés, souffrant de maladies chroniques - telles que le Covid long, l’encéphalomyélite myalgique, maladie de Lyme - et pour davantage de fonds accordés à la recherche, cet ouvrage nous fait repenser notre rapport à la maladie.
L’auteur
Johann Margulies (promo 12) est écrivain et philosophe. Il a enseigné la politique écologique à Sciences Po. À la suite d’une maladie chronique qui a bouleversé sa vie, il milite pour la reconnaissance des maladies chroniques invisibles.