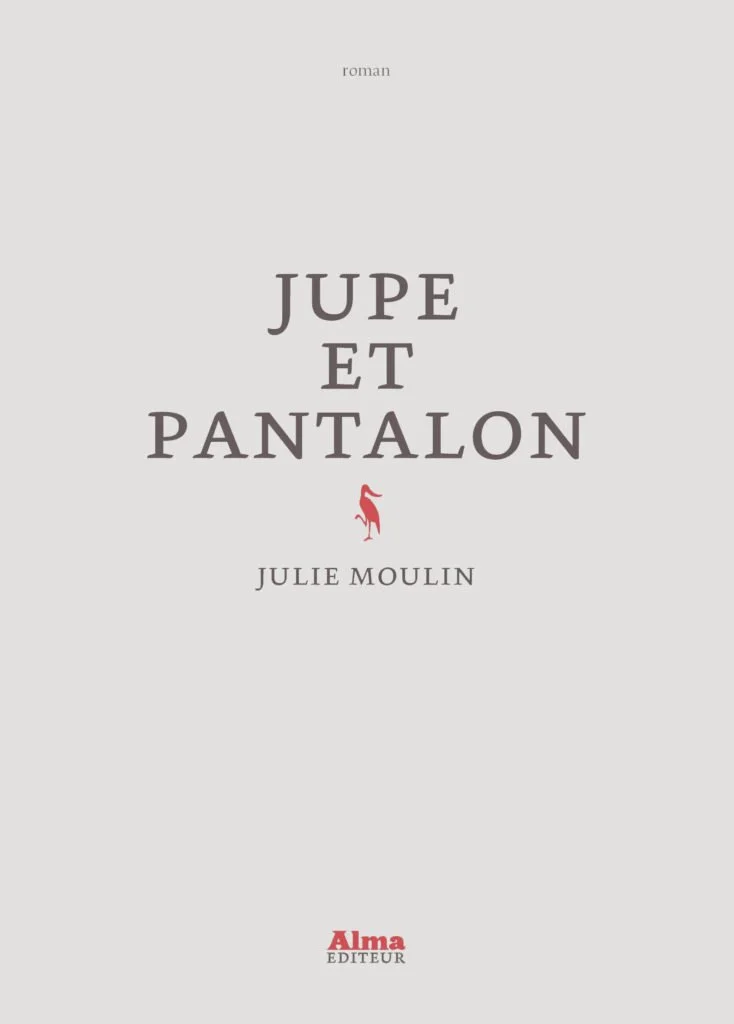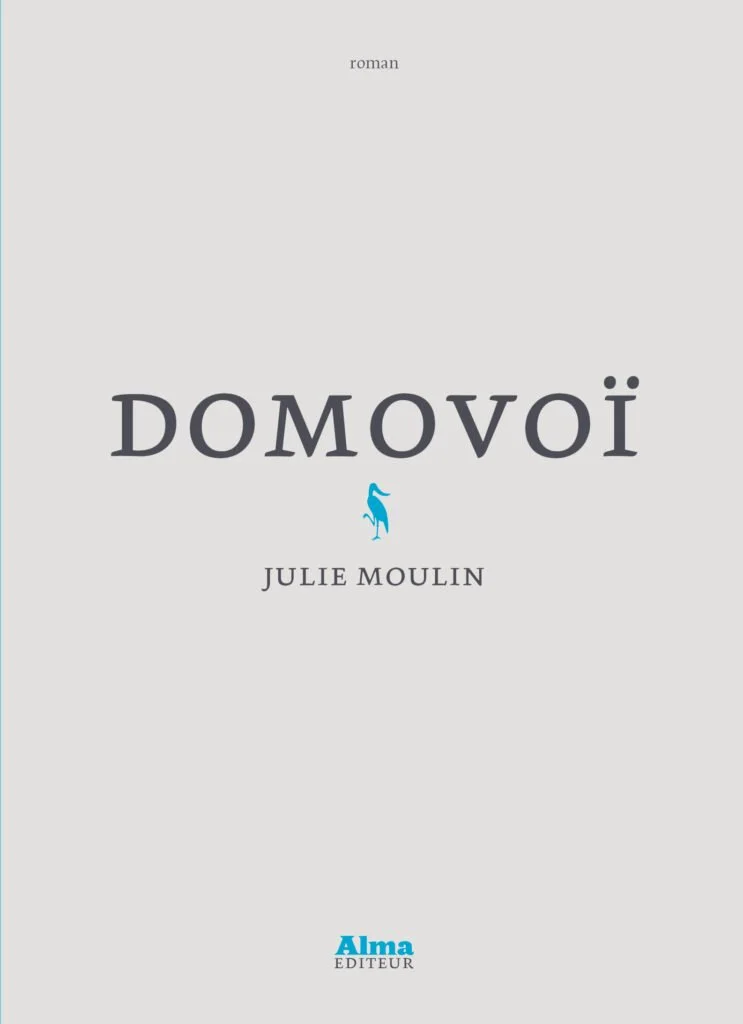Julie Moulin : "Pour comprendre un pays, il faut s’imprégner de sa littérature"
Expatriée à Singapour depuis 2020, Julie Moulin anime depuis un an le podcast Marcher entre les lignes, où elle part à la rencontre d’auteurs et partage ses expériences de lecture. Un projet qui lui tient vraiment à cœur, après un parcours impressionnant, de Sciences Po à la microfinance, en passant par l’ingénierie, l’écriture et une perte de mobilité. Émile l’a rencontrée.
Propos recueillis par Lisa Dossou
Pourquoi avoir choisi Sciences Po ? Quelles étaient vos ambitions ?
J'ai intégré Sciences Po en 1997, après un an de prépa ENS Cachan. Je voulais continuer à étudier les sciences humaines et sociales de façon très large, j’avais encore envie d’apprendre. C’est surtout ça : je n’avais pas envie de me spécialiser, pas d’idée de métier en tête et Sciences Po me paraissait le meilleur endroit pour continuer d’être curieuse du monde. Après la première année qui était assez générale, j’ai choisi la section communication, surtout parce que les autres spécialisations m’intéressaient moins. Ce que j’ai vraiment appris à Sciences Po, et que je continue d’appliquer aujourd’hui, c’est un esprit de synthèse et d’analyse, une méthode, un esprit critique. Ensuite, j’ai intégré un DEA sur les pays de l’Est, guidée par mon tropisme russophone, mais je ne suis pas allée au bout. Je travaillais en même temps dans un journal spécialisé sur les questions d’hydrocarbures, et je m’y suis davantage consacrée.
D’où vous vient ce tropisme russophone ?
Alors il faut savoir que je n’ai aucun horizon russe ou de la région dans ma famille. C’est arrivé plutôt par hasard. Mon collège proposait le russe en deuxième langue et j’ai trouvé ça amusant alors je l’ai pris. ça aurait pu être n’importe quelle autre langue, mais c’était le russe. Le fait est que j'ai eu une professeure de russe absolument extraordinaire qui nous a transmis son virus pour la Russie. Elle nous a emmené dès la troisième en Russie. À partir de là, ça a été vraiment un coup de foudre. Pour moi, adolescente, découvrir la Russie en 1993, c'était incroyable. Je n'avais pas l'habitude de voyager, c'était un monde totalement nouveau. Depuis, j’ai toujours voulu m’y rendre le plus possible, ce que j’ai pu faire grâce à mon travail mais aussi pour du tourisme, avec ma famille.
Quel a été votre parcours après Sciences Po ?
Même si j’aimais beaucoup ce travail dans le journal, en lien avec la Russie, j’ai finalement décidé de faire un master d’ingénierie à l’Institut français du pétrole. Grâce à mon russe, je suis partie trois mois en échange à l’Institut Gubkine à Moscou, puis j’ai terminé la formation à Rueil-Malmaison où j’ai appris l’analyse financière. Ensuite, j’ai effectué un stage à New York chez Gaz de France, avant d’intégrer BNP Paribas à Genève en 2003, où j’ai travaillé trois ans dans le financement des pétroliers et gaziers russes. Puis, je me suis orientée vers la microfinance : pendant six ans, j’ai voyagé en Biélorussie, Ukraine, Russie, Caucase et Asie centrale. La microfinance me passionnait, c’est un véritable outil de lutte contre la pauvreté et un vrai outil pour le développemnt économique. Puis j’ai commencé à écrire. Et là je me suis dis que ça faisait peut-être un peu beaucoup, entre le travail, les voyages, les enfants, l’écriture. J’ai donc pris une année sabbatique… et je ne suis jamais revenue ! Pour compléter ma formation, j’ai étudié le russe à l’INALCO de 2017 à 2020, année où j’ai déménagé à Singapour.
Est-ce à partir de cette année sabbatique, en 2012, que vous commencez à vous consacrer à l’écriture ?
Petite, j’ai toujours aimé lire et écrire. En fait, c’est plutôt Sciences Po qui m’a fait cesser d’écrire, je ressentais un manque de légitimité. Je continuais de lire en revanche, énormément et c’est difficile aussi d’écrire quand on lit. On se dit que beaucoup de sujets sont déjà abordés, qu’il existe tellement d’auteur.ices. Et puis un jour, je me suis imaginé une histoire où une de mes jambes parlait à l'autre jambe et elle lui disait « Bon, écoute, ça suffit, cette vie-là, je me casse. » Et l'autre jambe disait « Tu vas pas partir sans moi quand même ! » Et je me suis rendue compte que mon ton, c'était plutôt un ton humoristique en fait. Je me suis amusée, sans objectif de roman ni quoi que ce soit, juste à écrire des scénettes, des dialogues, entre des jambes commentant ma vie ou la vie de personnes que je connaissais ou que je côtoyais. Et de fil en aiguille, je me suis dit que je pouvais et que je voulais en faire un roman. J’avais quelque chose à raconter et écrire est devenu presque une urgence. J’ai quand même quitté mon travail pour écrire ! Donc voilà, mon premier roman, Jupe et Pantalon (Alma Editeur, 2015), est né comme ça.
Votre second roman s’appelle Domovoï, qu’est ce que cela veut dire ?
Le mot vient du russe et renvoie à la mythologie slave : le Domovoï est l’esprit protecteur du foyer, souvent décrit comme un petit lutin ou gnome, parfois mignon dans de vieux dessins animés soviétiques. Il habite la maison, veille sur la maisonnée et joue des tours si les habitants manquent à leur morale. J’ai choisi ce terme parce que, dans un contexte de crise migratoire, de montée des nationalismes et de guerre en Ukraine, je voyais le Domovoï comme le reflet d’un « lutin identitaire » : Quand on se protège, est-ce qu’on ne s’enferme pas en se coupant des autres ?
“« Quand on se protège, est-ce qu’on ne s’enferme pas en se coupant des autres ? »”
Vivre à la frontière suisse et la traverser quotidiennement renforçait cette idée de protection : le roman interroge ces questions d’identité, de culture, et d’éducation. L’héroïne, une étudiante de 20 ans à Sciences Po en 2015, part à Moscou pour comprendre pourquoi sa mère, décédée quand elle était enfant, aimait tant la culture russe. Pour éviter tout anachronisme, j’ai mené des recherches et me suis mis dans la peau d’une étudiante, pour restituer fidèlement un Moscou et un Sciences Po de 2015, loin de ceux que j’ai connus, beaucoup plus tôt.
Comment s’est déroulé votre déménagement à Singapour, en 2020 ?
Avec mon mari, on souhaitait vivre à l’étranger avec nos enfants. C’était une aventure familiale et Singapour est la seule destination qui s’est profilée. J’admets qu’au début, j’y suis allée à reculons, surtout enjouée par l’idée que je pourrais aller à Vladivostock et découvrir l’extrême orient russe. Mais en arrivant, l’envie de découvrir à bien sûr pris le dessus sur ces appréhensions, j’ai visité énormément de choses ! Le fait est qu’on a déménagé en plein Covid donc les frontières étaient fermées. Ensuite, j’ai eu un accident de santé assez important qui m’a causé un handicap et puis la Russie a envahi l’Ukraine … le plan est tombé à l’eau. Mais Singapour est une super expérience, j’ai découvert un pays qui est beaucoup plus que ce que l’on en dit, loin du côté bling-bling dont on l’accuse souvent, des clichés sur les français qui vivent là-bas …
En quoi votre perte de mobilité a modifié votre rapport à l’île ?
J’ai été sept mois valide à Singapour donc j’ai eu ces sept mois pour visiter, découvrir. D'ailleurs, je trouve que la première année d'expatriation, c'est amusant, parce que c'est un peu structurant, tout est nouveau. On a besoin de retrouver des repères, tout en restant des touristes. C'est comme si c'était une année de vacances, j’ai beaucoup aimé ce sentiment. Pendant sept mois j'écrivais, j'avais des travaux d'écriture en cours mais je visitais énormément d’endroits. Quand il y a eu cet accident, il n’y pas eu de temps pour la frustration, tout allait vite, il y avait un manque de visibilité total. Pendant deux ans, c’était vraiment difficile, je voulais surmonter ça, tenir le coup. J’ai été alitée et je ne pouvais plus du tout écrire. Alors j’ai beaucoup lu, de la littérature singapourienne notamment, la Singlit, parce que je suis persuadée que pour comprendre un pays, il faut s’imprégner de sa littérature. C’est aussi en partie grâce à la lecture que j'ai découvert la Russie d’ailleurs. Aujourd’hui je lis même directement en russe !
“« Je suis persuadée que pour comprendre un pays, il faut s’imprégner de sa littérature. »”
C’est là que l’idée de podcast vous vient, pour partager vos expériences ?
Au début je lisais pour moi, sans objectif de transmission, parce que alitée, je ne pouvais que lire. Mais mon objectif était encore d’écrire et quand cette perspective semblait difficile, j’ai pensé à enregistrer des livres audio, parce que ça pourrait servir à des personnes hospitalisées, alitées comme moi. J’ai voulu suivre une formation pour savoir poser ma voix et utiliser un logiciel de montage. Pour un tas de raisons, je n’ai pas pu y assister, mais j’ai finalement recontacter le musicien qui proposait la formation pour lui faire part de mon envie de la suivre. Il m’a répondu « Il faut que tu aies un sujet, un contenu. » Et c’est là que me vient l’idée de parler des romans ou des recueils de nouvelles que j’avais lues, écrites par des auteurs singapouriens. En avril dernier, on a donc fait cette formation et monté un premier épisode. Au même moment, mon roman se fait refuser par mon éditrice. Et en fait je me rends compte que dans le podcast et peut être contrairement au roman, je pourrais partager des choses qui me passionnent, dont j’ai foncièrement envie de parler.
Comment décririez-vous la littérature singapourienne ? En quoi se différencie-t-elle des autres ?
Ce qui m’interpelle dans la Singlit comme on l’appelle, c’est que la parole y est très libre. J’ai été assez étonnée de cette liberté parce que quand on est arrivés, on a vite compris que certains sujets étaient tabous. Par exemple, au cinéma, il peut y avoir des films ou des documentaires qui ne sont pas proposés à Singapour, ou qui doivent passer sous le coup de la censure avant, ou n’être proposés qu’à un certain public … Pareil pour le théâtre, une exposition etc. Mais pas la littérature ! Un poète m’a expliqué que c’est parce que ça n’embête personne, ce n’est pas un média de masse. C’est vraiment ça qui attise ma curiosité : à chaque nouvelle lecture, je suis stupéfaite et découvre un esprit critique et une nouvelle facette de Singapour, qui est tellement multiculturelle que chaque livre est une plongée dans une culture particulière.
Où en est le podcast aujourd’hui ?
Il a beaucoup de succès auprès de la communauté expatriée de Singapour qui me soutient énormément. En fait, c’est une forme d’écriture à part entière, j’écris mes épisodes, les interviews d’auteur ... chaque épisode explore un thème différent qui nous fait découvrir une autre facette de Singapour. Pour l’instant, les épisodes sont en français, avec quelques extraits en anglais traduits, mais je suis en train de transférer les épisodes sur Youtube avec des sous-titres en anglais et en français qui permettront au plus grand nombre de les écouter. Il y a des gens qui sont là depuis des dizaines d’années qui me disent « En écoutant tes épisodes, je découvre Singapour ! », et ça c’est le meilleur compliment qu’on puisse me faire. C’est vraiment une super aventure, ça fait déjà un an ! J’ai comme l’impression que c’est un premier cycle qui se termine.
Quels sont vos projets en cours ?
“ « Je pense que tout décentrage est vraiment propice à la création »”
Je suis très heureuse car mon recueil de nouvelles, que j’avais commencé à écrire quand j’étais alitée, va être publié ! C’était pas gagné parce qu’en France, ce n’est pas ce qui se commercialise le mieux. Ce sont des nouvelles inspirées par Singapour, même si je ne la nomme jamais. Le ton est plutôt fictionnel et absurde, décalé, c’est vraiment ce que j’avais envie d’écrire. Le recueil devrait sortir au premier semestre 2026. Je réfléchis aussi à l’avenir du podcast, je pense peut être à changer le rythme, surtout si je décide de repartir dans un projet d’écriture, auquel cas j’y consacrerai beaucoup de temps … Je pense que mon déménagement, que tout décentrage en fait, est vraiment propice à la création. Il y a quelque chose qui s'active parce qu'on est soudain entouré par de la nouveauté, de l'étrangeté, et on s'interroge. Comme dirait Pierre Vainclair dans La poésie française de Singapour : « Le poète qui s'immerge dans un contexte qui n'est pas le sien, que ce soit une autre langue ou loin de chez lui, devient effectivement le lieu d'une traduction. »