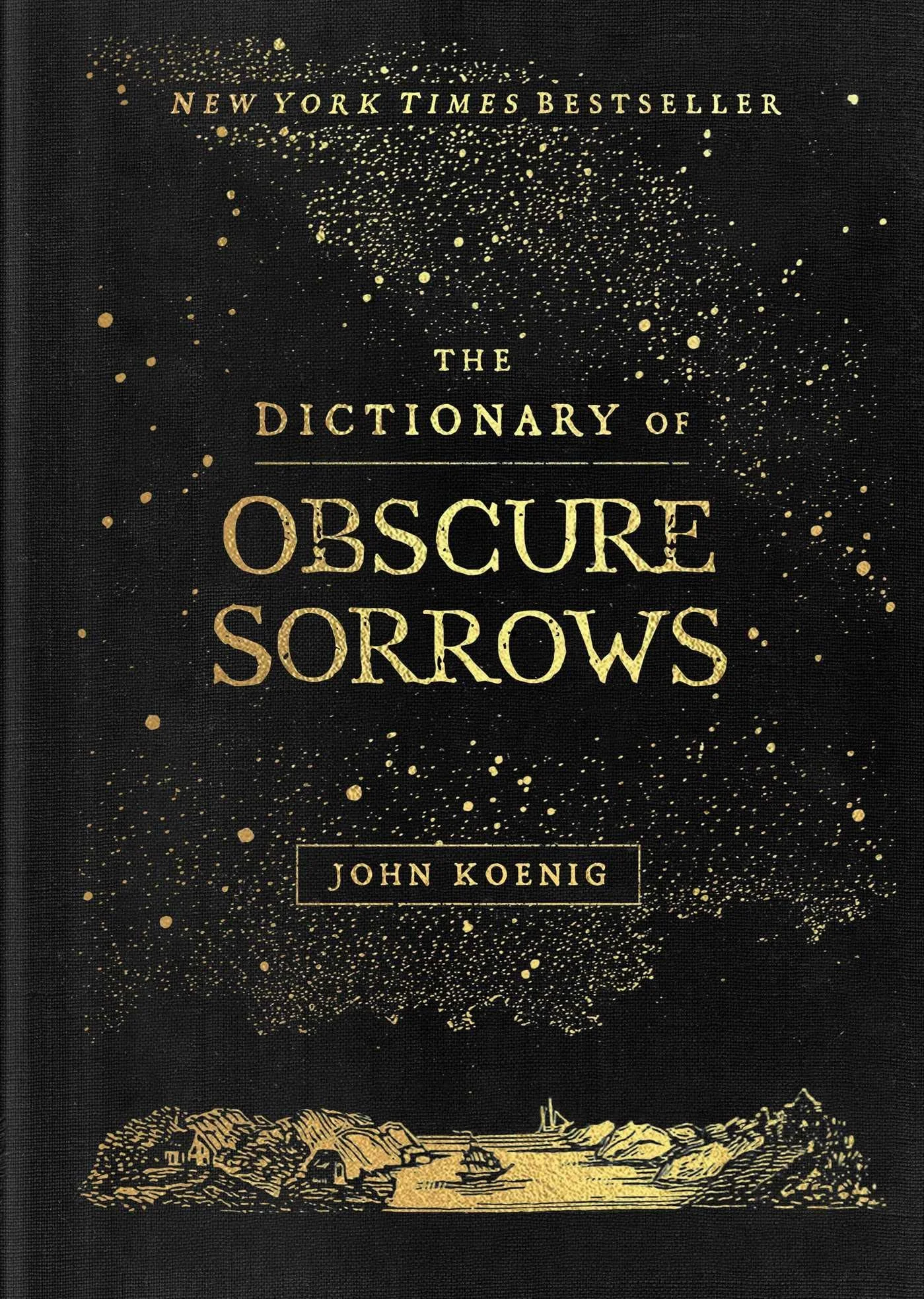Anemoïa ou le rêve d’un passé fantasmé
Filtres VHS, playlists années 80, tutos crochet et tricot sur TikTok : la Gen Z semble prise d’une étrange nostalgie pour des temps qu’elle n’a pas connus. Derrière ce phénomène se dessine le portrait d’une jeunesse en quête de repères, d’émotions rassurantes et d’un ailleurs temporel idéalisé. Mais à trop regarder en arrière, ne risque-t-on pas d’oublier d’inventer l’avenir ?
Par Alessandra Martinez
SUR TIKTOK, UN FORMAT VIRAL POPULARISE CES DERNIÈRES ANNÉES DES EXTRAITS VIDÉO DE LYCÉES DES ANNÉES 1990 : SOURIRES SPONTANÉS, COULOIRS SANS TÉLÉPHONE, AMBIANCE INSOUCIANTE. Des images compilant des séquences d’une fin d’année de lycée en 1999 avec pour sous-titre « Phones ? No. We had each other » compte plus de cinq millions de vues et près de 30 000 commentaires, dont bon nombre écrits par la Gen Z : « This feels nostalgic despite me not even existing during this time » ; « Born in 2003... I’m jealous of millennials/Gen X ». Bienvenue dans l’ère de l’anemoïa.
Une mémoire sans souvenirs
Ce terme, forgé par John Koenig dans The Dictionary of Obscure Sorrows à partir du grec ancien ánemos (vent) et nóos (esprit), désigne la nostalgie d’un temps que l’on n’a pas vécu. Cette émotion, aussi douce qu’imprécise, s’incarne aujourd’hui dans des contenus calibrés, esthétisés, dans lesquels flâne la Gen Z. Et cette rêverie n’est pas anodine. En creux, elle raconte un malaise. Dans un contexte de crises multiples – climatiques, géopolitiques, économiques –, cette fixation sur un passé fantasmé agit comme une échappatoire. Le présent inquiète, l’avenir angoisse. Alors on se tourne vers des époques supposées plus simples, aux repères stables, aux émotions plus lentes, aux relations plus humaines. Une rébellion douce, silencieuse, presque invisible : ne pas changer le monde, mais s’en retirer symboliquement. Des études menées par des supports utilisés par les jeunes générations (YouGov x Adobe en 2023, ou encore Spotify « Culture Next », également en 2023) démontrent qu’elles pensent davantage au passé que leurs aînés : plus d’un tiers des 16-25 ans ressentent de la nostalgie pour les années 90, décennie qu’ils n’ont pourtant pas connue. Ce phénomène témoigne d’un désir de ralentir.
L’usine à nostalgie
Mais l’être humain n’est pas à un paradoxe près : si la GenZ aspire à ralentir, se recentrer, recréer du lien, cette quête passe par les mêmes plateformes qui alimentent la fatigue informationnelle et l’hyperconnexion. On prône la slow life, tout en scrollant à haute fréquence. On rêve d’authenticité, tout en reproduisant des contenus très codés. Il y a là une tension non résolue : vouloir se déconnecter d’un monde jugé toxique, tout en restant prisonnier de ses outils. Dans une culture saturée d’images recyclées, les plateformes jouent un rôle central : TikTok, Instagram ou Pinterest propulsent en boucle des fragments d’archives, des effets VHS, des couleurs délavées, des textures analogiques. Les algorithmes affinent leur rôle de curateurs invisibles : ils détectent les préférences pour les sonorités synthétiques, les esthétiques vintage, les cadrages façon Polaroid, et les reproduisent jusqu’à saturation. Le passé devient ainsi un flux d’images recomposées, une mémoire collective recréée, modelée non plus par l’expérience, mais par la recommandation automatisée. Une nostalgie sans histoire, un imaginaire prêt à consommer, conçu pour le partage et le buzz. L’anemoïa devient la « fauxstalgia », version marketée d’un passé recomposé, un levier que les marques et les plateformes n’ont pas tardé à s’approprier.
“« Le passé devient un flux d’images recomposées, une mémoire collective recréée, modelée non plus par l’expérience, mais par la recommandation automatisée. »”
Des imaginaires idéalisés
C’est ainsi que prospèrent les vidéos « Day in my life 80’s », les reconstitutions de chambres adolescentes des années 90, les planches de moodboards saturées de grain... Sur Instagram, le hashtag #cottagecore (terme popularisé sur internet par des adolescents et des jeunes adultes idéalisant la vie rurale) comptabilise plus de six millions d’occurrences. D’autres modes, comme la dark academia (tendance esthétique prenant l’université du XIXe-début XXe siècle comme inspiration visuelle : port d’uniformes, campus à architecture gothique, zéro technologie pour suivre les cours...) ou celle des tradwives (esthétique rétro et rôles féminins traditionnels ou stéréotypés : pour fuir la complexité du monde moderne, la femme s’efface, reste au foyer et se concentre sur sa vie domestique) revisitent le passé, en effaçant soigneusement ses aspérités. Tout est esthétisé, idéalisé, dépouillé des tensions sociales et politiques. L’anemoïa devient une rêverie propre, maîtrisée, déconnectée du réel.
Le risque est donc de se perdre dans cette contemplation. À force d’idéaliser des époques réinventées, on finit par oublier de construire de nouveaux récits. Le crochet, les filtres VHS, les vestiaires vintage – tout cela compose un langage visuel séduisant, mais peut-il suffire comme horizon d’avenir ? La nostalgie devient alors un refuge esthétique, mais aussi un piège : celui d’une jeunesse qui regarde derrière pour se rassurer au lieu de se tourner vers demain. Reste peut-être à envisager cette réappropriation esthétique comme une étape, un matériau brut à sublimer. Car si ce passé recomposé peut nourrir l’imaginaire, il peut aussi devenir un tremplin créatif – à condition d’être interrogé, bousculé, déplacé.
Cet article a initialement été publié dans le numéro 33 d’Émile, paru à l’été 2025.