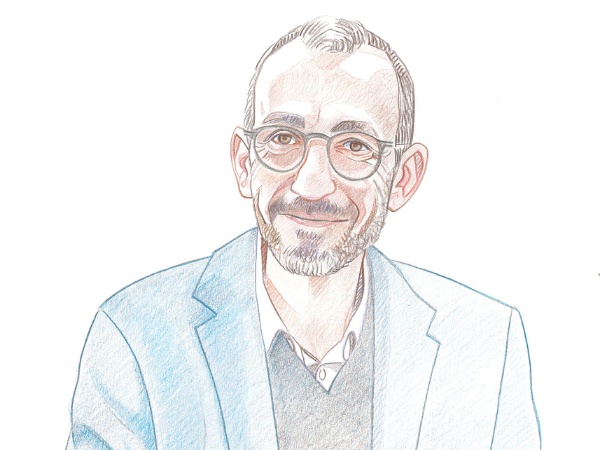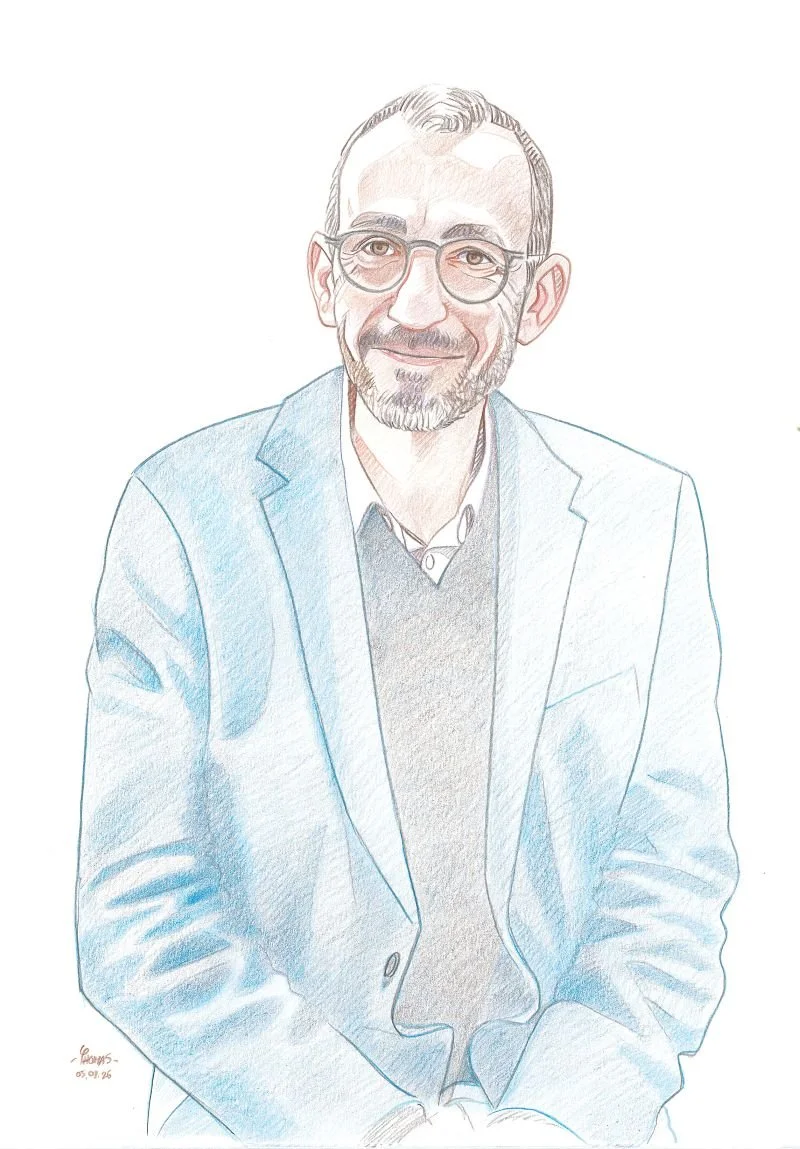Jérôme Ferrari, écrire pour échapper à soi-même
Prix Goncourt 2012 pour Le Sermon sur la chute de Rome, Jérôme Ferrari est, depuis le mois de janvier, le nouvel écrivain en résidence de la chaire d’écriture de Sciences Po, succédant ainsi à Carole Martinez.
Propos recueillis par Thomas Arrivé
Vos romans tournent souvent au jeu de massacre. Est-ce un procédé pour faire tenir l’intrigue ou avez-vous une vision pessimiste de l’humanité ?
Je suis sincère. Je n’emploie pas de procédé. Je ne suis pas nihiliste pour autant. Mais c’est vrai que la noirceur offre un matériau plus fécond que le bonheur. J’admire les auteurs qui sont capables d’écrire à partir de la vertu morale, comme le fait Vassili Grossman, par exemple, en témoignant de sa foi dans l’humanité malgré la Seconde Guerre mondiale. Moi, je ne peux pas.
Vous contestez pourtant l’image que Mérimée a associée à la Corse avec Colomba : une Corse de la violence et de la vendetta.
Oui, mais pas parce que c’est noir, seulement parce que c’est faux. C’est un cliché, qui est contemporain de la littérature romantique. C’est vieux. Et même à l’époque, c’était inexact : une façon de réduire la Corse à un exotisme. Il faut au contraire faire entrer la Corse dans la dignité littéraire, pour reprendre l’expression de Jean-Baptiste Prédali.
“« J’ai toujours accordé de l’importance à l’esthétique dans mon écriture : produire quelque chose de beau. »”
Quelle place accordez-vous à la beauté ? Vous vous moquez des touristes qui s’émerveillent en descendant du bateau.
C’est parce qu’ils s’émerveillent pour n’importe quoi [rires, NDLR]. Pour moi, la beauté est doublement importante. D’abord, j’ai une relation physique aux paysages, presque charnelle. Je peux, encore aujourd’hui, être saisi par des endroits que je connais depuis tout petit. Ça tient peut-être à la géologie. Au détour d’un virage, je suis ébahi. Je pense à Piana, entre autres. Ensuite, j’ai toujours accordé de l’importance à l’esthétique dans mon écriture : produire quelque chose de beau. Ce n’est pas une obligation, après tout. C’est même un problème quand ce qu’on décrit ne l’est pas. Mais j’ai toujours été travaillé par la parenté entre le beau et le vrai.
Vous avez écrit un roman (Le Principe) sur la science physique, où vous tirez au contraire le sujet vers la bombe atomique plutôt que vers la beauté des équations.
Je me suis saisi de ce paradoxe tragique. Heisenberg, le personnage principal (qui a vraiment existé) avait un sens esthétique de l’abstraction, un sens mystique de la beauté des mathématiques. Mais ses travaux sont à l’origine de la bombe atomique, alors que personne n’y pensait dans sa communauté : à l’origine, ce domaine scientifique était la quintessence du savoir gratuit. J’ai écrit sur cette ironie.
Vous avez fait des traductions corse-français. Est-ce que la francophonie a pour vous un sens particulier ?
Pas si l’on considère la langue française comme une langue unique, émanant d’un centre parisien. Le français est parlé par plusieurs communautés distantes, qui en font chacune leur affaire. Dans mes romans, dans les dialogues en particulier, je n’emploie même pas le français tel qu’il est parlé par les Corses, avec sa syntaxe particulière ou ses transfuges de la langue corse. Même chose dans les traductions dont vous parlez : la transposition devait se faire vers un français beaucoup moins situé. Parce que dans la réalité, le français tel qu’il est parlé par les Corses est très particulier.
Treize ans après le Goncourt, est-ce que vous vous êtes remis du poids que ce prix peut représenter ?
J’étais enseignant en poste aux Émirats, quand c’est arrivé : j’étais donc à l’abri de la pression médiatique. Et je n’en étais pas à mon premier roman. Sinon, le Goncourt est peut-être un cadeau empoisonné. Je dirais qu’il faut garder à l’esprit qu’on n’est pas élu des dieux, mais seulement le jouet de certaines circonstances. Le piège, ensuite, est de faire du roman lauréat une matrice d’où toute la suite doit sortir. J’ai fait le contraire, en écrivant sur Heisenberg aussitôt après. Avec tous ces garde-fous, c’est plutôt une bonne nouvelle : du confort matériel, de la visibilité. Je suis ravi que Mauvignier y ait eu droit cette année.
“« Je fais cours autour de la connaissance des textes. En lisant, on découvre un terrain qu’on n’avait pas soupçonné. »”
Comment abordez-vous l’atelier d’écriture de Sciences Po ?
J’ai toujours enseigné. Je suis encore professeur de philosophie, au lycée Voltaire, à Paris. Mais un atelier d’écriture est une nouveauté pour moi. J’ai accepté la proposition de Sciences Po parce que les retours qu’en ont fait mes prédécesseurs étaient positifs : Mathias Enard, Maylis de Kerangal. Je fais cours autour de la connaissance des textes. Je ne me vois pas faire autrement. En lisant, on découvre un terrain qu’on n’avait pas soupçonné. J’ai choisi deux thèmes : la violence et l’altérité. Le premier renvoie à des textes de Grossman, McCarthy, Mauvignier. Comment concilier ce sujet et l’esthétique de l’écriture ? Il y a là un piège moral. Quant au second sujet, l’altérité, il tient à ma conviction que la fiction consiste à sortir de soi : c’est le contraire d’un journal intime. Ce sont par exemple les observations d’Hans Staden, au XVIe siècle, qui a passé huit mois en captivité chez des anthropophages d’Amazonie : de l’ethnographie avant l’heure.
Des écrivains en résidence à Sciences Po
Chaque semestre, depuis 2018, le Centre d’écriture et de rhétorique (CER) de Sciences Po invite un écrivain en résidence. L’auteur y dispense des enseignements d’écriture de création, anime des master class et participe à divers événements culturels et littéraires. Le centre offre aux étudiants un espace de création, d’apprentissage et d’enrichissement aux côtés d’écrivains et d’éditeurs reconnus.
Cet article paraîtra dans le numéro 35 du magazine Émile (mars 2026).